Introduction aux Pères de l'Église
Les développements ci-dessous sont une introduction générale à la patristique. Certains Pères de l'Église sont plus particulièrement abordés dans le thème de la sexualité, du mariage et de la virginité.
Introduction
L’appellation « Pères de l’Église » désigne un ensemble d’auteurs chrétiens de l’Antiquité dont l’autorité doctrinale, spirituelle et institutionnelle a façonné, entre le Ier et le VIIIe siècle, les fondements de la pensée chrétienne. Leur rôle ne se limite pas à l’élaboration intellectuelle : ils sont également acteurs de la structuration ecclésiale, de la transmission scripturaire, de la lutte contre les hérésies et de l’inculturation du message évangélique dans l’espace gréco-romain. Le christianisme, en tant que réalité communautaire et doctrinale, n’émerge pas d’un bloc au IVe siècle, mais se constitue progressivement par une série de controverses, de synthèses et d’autorités reconnues. C’est dans ce processus dynamique que s’inscrivent les Pères de l’Église, dont les écrits constituent à la fois un socle théologique et un corpus d’interprétation. Comme le rappelle Henri-Irénée Marrou, « la patristique n’est pas seulement un âge d’or de la pensée chrétienne, elle est le moment où cette pensée acquiert ses catégories » (Marrou, Patristique et humanisme, 1969).
L’enjeu d’une étude approfondie des Pères de l’Église ne se limite pas à la restitution historique. Leur pensée irrigue encore les débats contemporains sur l’ecclésiologie, la christologie, la sacramentalité, l’exégèse biblique et la relation entre foi et raison. Comprendre leur production intellectuelle suppose d’articuler trois niveaux d’analyse : les conditions historiques et culturelles de leur émergence ; les apports doctrinaux, spirituels et institutionnels ; la réception et la postérité de leurs œuvres dans les différentes traditions chrétiennes. Ce triple éclairage permet de saisir comment la formulation des dogmes, la structuration liturgique, l’organisation hiérarchique de l’Église et l’herméneutique biblique se sont cristallisées à travers leurs œuvres.
La problématique centrale de cette étude est donc la suivante : comment les Pères de l’Église ont-ils contribué à l’unification doctrinale, à la construction ecclésiale et à la transmission d’un héritage théologique durable ? Pour y répondre, l’analyse suivra une progression en trois mouvements : d’abord une mise en contexte historique, social et intellectuel de la production patristique ; puis une étude des grands apports doctrinaux, herméneutiques et spirituels ; enfin un examen de la postérité et des réappropriations de la pensée patristique jusqu’à l’époque contemporaine.
I. Contexte historique et genèse de la littérature patristique
1.1. Délimitation chronologique et diversité des profils
L’appellation « Pères de l’Église » ne correspond pas à un groupe homogène mais à une construction historiographique progressive. Les premiers auteurs reconnus comme tels sont les Pères apostoliques, actifs entre la fin du Ier siècle et le début du IIe. Leurs écrits témoignent d’une Église encore proche des communautés fondées par les apôtres. Ignace d’Antioche incarne cette génération de transition, dont les lettres insistent sur l’unité ecclésiale, l’autorité de l’évêque et la centralité de l’eucharistie (Ignace d’Antioche, Lettre aux Smyrniotes). Son contemporain Polycarpe de Smyrne, disciple de Jean selon la tradition, contribue à stabiliser la doctrine face aux interprétations divergentes (Polycarpe, Lettre aux Philippiens).
Au IIe siècle émergent les apologistes, qui défendent la foi face aux critiques païennes et cherchent à dialoguer avec la philosophie antique. Justin Martyr revendique l’usage du logos comme principe commun entre raison et Révélation (Justin, Première Apologie). Athénagore d’Athènes, Tatien ou Théophile d’Antioche s’inscrivent dans cette tentative de légitimation intellectuelle du christianisme. C’est également à cette époque qu’apparaissent les premières tensions liées aux doctrines gnostiques, marcionites ou montanistes, ce qui entraîne une réflexion accrue sur le canon scripturaire et l’autorité de la tradition.
Le IIIe et surtout le IVe siècle voient se développer des foyers théologiques majeurs. L’école d’Alexandrie, représentée par Clément et Origène, valorise une lecture allégorique de l’Écriture et puise dans le platonisme pour élaborer une théologie spirituelle (Origène, De principiis). À l’inverse, l’école d’Antioche, avec Théodore de Mopsueste ou Diodore de Tarse, privilégie une approche plus littérale, historique et christologiquement prudente. Ces deux traditions herméneutiques nourriront ultérieurement les controverses christologiques.
Dans l’espace latin, Tertullien inaugure au IIIe siècle une théologie juridique et polémique, marquée par le souci de précision terminologique (Tertullien, Adversus Praxean). Cyprien de Carthage défend l’unité de l’Église autour de l’évêque et articule ecclésiologie et martyre (Cyprien, De Unitate Ecclesiae). Avec Ambroise, Jérôme et Augustin au IVe–Ve siècles, l’Occident se dote d’une autorité doctrinale comparable à celle des Cappadociens en Orient.
Les Pères cappadociens (Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse) jouent un rôle décisif dans la formulation trinitaire. Ils introduisent une distinction conceptuelle entre ousia (essence) et hypostase (personne), permettant d’articuler unité et distinction au sein de la divinité (Grégoire de Nysse, Contre Eunome). Athanase d’Alexandrie, quant à lui, défend dès le concile de Nicée (325) la pleine divinité du Fils face à l’arianisme (Athanase, De l’Incarnation du Verbe).
Enfin, la période dite post-nicéenne voit se consolider des figures à la charnière entre grâce et institution. Jean Chrysostome, par ses homélies exégétiques et morales, participe à diffuser une théologie populaire et pastorale. Au Ve siècle, Léon le Grand contribue à fixer la christologie orthodoxe avec son Tome à Flavien.
Cette diversité géographique, culturelle et doctrinale montre que la patristique ne se réduit pas à une école unique, mais correspond plutôt à un moment de créativité doctrinale et institutionnelle dont l’unité se construit progressivement.
1.2. Cadre sociopolitique et transformations de l’Empire
L’émergence et le rayonnement de la pensée patristique ne peuvent se comprendre sans prendre en compte le contexte sociopolitique de l’Antiquité tardive. Entre le Ier et le IVe siècle, le christianisme se développe au sein d’un Empire romain traversé par des tensions politiques, des mutations culturelles et des recompositions religieuses. Dans un premier temps, les communautés chrétiennes évoluent dans une relative marginalité, parfois dans la clandestinité, souvent dans la suspicion. Les persécutions, bien que variables selon les époques et les régions, constituent un facteur structurant de l’identité chrétienne primitive. Le témoignage des martyrs, relayé par des Actes ou des Passions, contribue à élaborer une théologie du sacrifice, de la fidélité et du salut (Tertullien, Apologeticum).
La situation change radicalement avec la conversion de Constantin et l’édit de Milan (313), qui accorde la liberté de culte aux chrétiens. Le christianisme cesse d’être une religion persécutée pour devenir progressivement une religion privilégiée. Ce basculement transforme les modalités de débat théologique : les controverses ne se déroulent plus uniquement dans les cercles locaux mais dans le cadre conciliaire, avec l’appui – ou l’ingérence – de l’autorité impériale. Le concile de Nicée (325) constitue un tournant en cristallisant les premières grandes décisions doctrinales sur la nature du Fils (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique).
La christianisation des structures de l’Empire entraîne également une nouvelle géographie ecclésiale. Des sièges épiscopaux majeurs (Rome, Antioche, Alexandrie, Constantinople, Jérusalem) apparaissent comme des foyers de définition doctrinale et d’autorité normative. Cette institutionnalisation permet certes une meilleure coordination, mais elle suscite aussi des tensions de pouvoir et des fractures doctrinales, comme le montrent les crises arienne, donatiste ou nestorienne.
Sur le plan culturel, le monde gréco-romain constitue le cadre intellectuel dans lequel les Pères élaborent leur pensée. Le recours à la philosophie ne relève pas de l’imitation servile, mais de l’appropriation critique. Justin considère la philosophie comme une « préparation évangélique » (Justin, Dialogue avec Tryphon), tandis que Clément d’Alexandrie voit dans le platonisme une pédagogie permettant d’accéder à une compréhension plus profonde de la Révélation (Clément, Stromates). À l’inverse, Tertullien se montre méfiant à l’égard de ce qu’il perçoit comme un risque de dénaturation de la foi (Tertullien, De praescriptione haereticorum).
Enfin, la période tardo-antique est marquée par des recompositions sociales profondes : le déclin des cultes traditionnels, l’essor des villes, la transformation des élites et l’évolution du droit impérial créent des opportunités nouvelles pour les chrétiens. La conversion de grandes familles aristocratiques, la formation d’un clergé cultivé et la naissance du monachisme témoignent d’une intégration progressive du christianisme dans la trame sociale.
1.3. Formes, transmissions et réception des écrits patristiques
La production patristique se déploie dans une diversité de genres littéraires qui reflète la pluralité des fonctions exercées par ces auteurs. Les traités dogmatiques visent à systématiser ou défendre une doctrine : Athanase rédige des écrits contre les ariens, tandis qu’Augustin compose des ouvrages monumentaux comme De Trinitate ou La Cité de Dieu, qui présentent la foi dans un horizon philosophique élargi. Les homélies constituent un autre vecteur majeur : Jean Chrysostome, Augustin ou Léon le Grand utilisent la prédication pour diffuser une théologie accessible, intégrant à la fois exégèse, exhortation morale et enseignement liturgique.
Les lettres jouent un rôle doctrinal, pastoral et institutionnel. Elles permettent la circulation des idées et la régulation des conflits. Cyprien de Carthage, en particulier, se sert abondamment de la correspondance pour statuer sur les questions disciplinaires (baptême des hérétiques, lapsi) et affirmer l’autorité épiscopale (Cyprien, Epistulae). Parallèlement, les règles monastiques, comme celles de Basile ou de Pachôme, codifient une forme de vie chrétienne radicale qui participe à la formation spirituelle et intellectuelle de l’élite ecclésiastique.
La question de la transmission des textes est essentielle. Avant la constitution de bibliothèques monastiques et épiscopales, la circulation repose sur des copies manuscrites produites dans des cercles restreints. L’autorité d’un écrit dépend souvent de la position de son auteur, de sa conformité à la tradition et de sa réception liturgique ou conciliaire. Certains écrits tombent dans l’oubli avant d’être redécouverts plus tard, comme l’œuvre d’Origène, longtemps suspecte puis partiellement réhabilitée au Moyen Âge.
La réception patristique est donc sélective et évolutive. Les conciles œcuméniques jouent un rôle de filtre et d’officialisation. Les textes de Basile, Grégoire de Nazianze ou Athanase sont rapidement intégrés à un canon théologique implicite en Orient, tandis que ceux d’Augustin acquièrent dans l’Occident latin une autorité déterminante à partir du Ve siècle. Le Moyen Âge redéploiera cette autorité en les insérant dans les collections canoniques et les florilèges théologiques.
Cette première partie permet de comprendre que la patristique est le produit d’un contexte mouvant, où se croisent héritage philosophique, mutations sociales, recompositions politiques et formation institutionnelle. Les sections suivantes montreront comment cette dynamique historique se traduit par des apports doctrinaux, herméneutiques et spirituels structurants.
II. Les apports doctrinaux, spirituels et herméneutiques
2.1. La lutte contre les hérésies : identité, orthodoxie et frontières doctrinales
L’un des traits structurants de la pensée patristique est sa confrontation permanente avec les doctrines considérées comme déviantes. Les hérésies ne sont pas de simples erreurs marginales : elles forcent les Pères à clarifier, formuler et systématiser des éléments doctrinaux encore implicites. Dès le IIe siècle, Irénée de Lyon s’oppose aux systèmes gnostiques, qu’il perçoit comme une menace directe contre la cohérence du message évangélique (Irénée, Contre les hérésies). Il défend le principe d’une Tradition issue des apôtres, transmise par la succession épiscopale et garante de l’unité doctrinale. Sa théologie de la « règle de foi » (regula fidei) constitue une étape importante dans l’articulation entre Écriture, tradition et interprétation.
Le marcionisme représente une autre forme de contestation majeure : Marcion rejette le Dieu de l’Ancien Testament, considéré comme étranger au Dieu de Jésus-Christ, et propose un canon réduit des Écritures. Cette position pousse les Pères à préciser le rapport entre Ancien et Nouveau Testament, à affirmer leur continuité et à défendre l’unité du canon biblique (Tertullien, Adversus Marcionem). De même, les mouvements montanistes, associant prophétisme, ascétisme rigoureux et contestation de la hiérarchie ecclésiale, obligent à redéfinir les modalités d’autorité dans l’Église.
Aux IIIe et IVe siècles, les controverses prennent une dimension plus institutionnelle et impériale. La crise arienne, déclenchée par les positions d’Arius niant la pleine divinité du Fils, oblige les évêques à clarifier les concepts de génération, de substance et de relation trinitaire. Le concile de Nicée (325) adopte la formule « homoousios » pour affirmer que le Fils est « consubstantiel » au Père. Athanase d’Alexandrie joue un rôle central dans la défense de cette position contre les compromis semi-ariens et les résistances locales (Athanase, Lettre à Sérapion).
Au Ve siècle, les débats christologiques illustrent encore cette dynamique. Nestorius, patriarche de Constantinople, refuse le titre de Theotokos (« Mère de Dieu ») pour Marie, afin de préserver la distinction entre nature humaine et nature divine du Christ. Cyrille d’Alexandrie s’oppose fermement à cette séparation, défendant la réalité de l’union incarnée (Cyrille, Contra Nestorium). Le concile d’Éphèse (431) condamne le nestorianisme. Quelques décennies plus tard, la controverse monophysite conduit au concile de Chalcédoine (451), qui affirme l’union des deux natures « sans confusion ni séparation, sans division ni changement ».
Ces affrontements doctrinaux ne se réduisent pas à des luttes d’influence : ils structurent durablement la pensée chrétienne. La formulation dogmatique se construit dans l’articulation entre fidélité scripturaire, lexique philosophique et institution ecclésiale. Comme le résume Jean Daniélou, « l’hérésie est le révélateur de la Tradition » (Daniélou, Histoire des doctrines chrétiennes, 1957).
2.2. La Trinité et la christologie : élaboration conceptuelle et enjeux théologiques
L’élaboration de la doctrine trinitaire représente l’un des acquis majeurs de la période patristique. Si le Nouveau Testament affirme la divinité du Père, du Fils et de l’Esprit, il n’en propose pas une conceptualisation unifiée. Les Pères, confrontés à la fois au polythéisme païen, aux courants subordinationnistes et aux critiques philosophiques, cherchent à exprimer la singularité du monothéisme chrétien.
Le concile de Nicée inaugure un tournant en fixant l’usage du terme homoousios, jusque-là contesté car absent de l’Écriture. Les Cappadociens affinent la distinction entre l’ousia (essence commune) et les hypostases (personnes distinctes), permettant de concilier unité et pluralité (Basile, Lettre 38 ; Grégoire de Nazianze, Discours théologiques). Ils insistent sur la coéternité et la coégalité des trois personnes divines, en évitant à la fois le modalisme (qui confond les personnes) et le trithéisme (qui les sépare).
La christologie suit une évolution parallèle. Selon les contextes, les Pères insistent tantôt sur la divinité du Christ (Ignace d’Antioche, Lettre aux Éphésiens), tantôt sur son humanité assumée (Irénée, Contre les hérésies). Au IVe siècle, Apollinaire de Laodicée propose une solution unitive qui minimise l’humanité complète du Christ ; cette position est rejetée car elle compromet le salut de l’homme tout entier (Grégoire de Nazianze, Lettre 101). La synthèse conciliaire de Chalcédoine (451) affirme deux natures unies dans une seule personne, définissant ainsi un cadre durable pour la théologie chrétienne.
La christologie patristique n’est pas une spéculation abstraite : elle répond à la question du salut. Athanase résume cette logique par la formule célèbre : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » (Athanase, De incarnatione, 54). L’incarnation est comprise non comme un événement symbolique, mais comme une transformation réelle de la condition humaine par l’union avec le Verbe. Cette théologie de la divinisation (théosis) est particulièrement marquée en Orient, tandis que l’Occident insiste davantage sur la rédemption, le péché originel et la grâce (Augustin, De Trinitate).
Les débats christologiques et trinitaires mettent en œuvre un langage conceptuel emprunté au platonisme, au stoïcisme et à l’aristotélisme. Cependant, les Pères ne se contentent pas de traduire le dogme en termes philosophiques : ils transforment ces catégories pour exprimer une vérité révélée. Ainsi, le concept d’hypostase, initialement vague, acquiert une signification technique dans le cadre de la théologie trinitaire.
L’élaboration doctrinale de la Trinité et de la christologie constitue l’une des contributions les plus durables des Pères : elle fonde l’unité de la Tradition et établit le cadre de la théologie médiévale et moderne.
2.3. Sacrements et ecclésiologie
La conception patristique des sacrements s’élabore progressivement en lien étroit avec la structuration de l’Église. Le baptême occupe une place centrale dès les premiers siècles : il est compris comme une nouvelle naissance, une illumination spirituelle et une incorporation au Corps du Christ (Justin, Apologie I ; Tertullien, De baptismo). Les catéchuménats, parfois longs et rigoureux, témoignent du sérieux accordé à l’initiation chrétienne. Cyrille de Jérusalem, dans ses Catéchèses mystagogiques, décrit le baptême comme participation réelle à la mort et à la résurrection du Christ, inscrivant le geste liturgique dans une théologie du salut et de la transformation.
L’eucharistie, souvent appelée « fraction du pain » ou « sacrifice spirituel », est comprise très tôt comme actualisation du mystère pascal. Ignace d’Antioche y voit un « remède d’immortalité » (Ignace, Lettre aux Éphésiens), tandis qu’Irénée affirme la transformation des espèces comme signe de la transfiguration de la création (Irénée, Contre les hérésies). Chez Augustin, le réalisme sacramentel s’accompagne d’une dimension ecclésiale : « recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous recevez » (Augustin, Sermon 272). La liturgie patristique articule ainsi symbolisme, mystère et communauté.
L’ecclésiologie se développe parallèlement aux sacrements. L’Église est comprise comme Corps mystique du Christ, peuple de Dieu et temple de l’Esprit. La communion ecclésiale repose sur la succession apostolique, la foi partagée et la célébration commune. Cyprien résume l’unité en une formule célèbre : « on ne peut avoir Dieu pour Père si l’on n’a pas l’Église pour Mère » (Cyprien, De catholicae unitate). Les débats sur la pénitence, les lapsi et le rebaptême témoignent des tensions entre miséricorde et rigueur, mais aussi du souci de préserver la cohésion communautaire.
Le ministère épiscopal se consolide comme instance de gouvernement, d’enseignement et de sanctification. Les conciles régionaux ou œcuméniques viennent progressivement définir les normes disciplinaires et doctrinales. L’Église apparaît à la fois comme réalité visible et mystère spirituel, enracinée dans l’histoire et ouverte à l’éternité.
2.4. Exégèse et herméneutique
L’exégèse patristique occupe une place centrale dans la formation de la doctrine et de la vie ecclésiale. Les Pères conçoivent l’Écriture comme une réalité inspirée, vivante et polysémique, qui exige une interprétation à la fois spirituelle et ecclésiale. Origène joue un rôle fondateur en systématisant une herméneutique à plusieurs niveaux : sens littéral, sens moral et sens spirituel (Origène, De principiis). Cette hiérarchie ne nie pas le texte, mais le déploie dans une perspective christologique et mystique.
En Occident, Jérôme incarne l’effort philologique. Sa traduction latine de la Bible, la Vulgate, s’appuie sur les textes hébreux et grecs, tout en respectant la réception ecclésiale (Jérôme, Prologus galeatus). Il défend une interprétation attentive au contexte et au lexique, tout en admettant des lectures typologiques. Augustin, pour sa part, relie herméneutique biblique et charité : « toute interprétation qui édifie dans l’amour est juste » (Augustin, De doctrina christiana).
La distinction orient-occident influe sur les méthodes. Alexandrie privilégie le sens allégorique (Cyrille d’Alexandrie, Commentaire sur Jean), tandis qu’Antioche met l’accent sur l’historicité et l’unité du texte (Théodore de Mopsueste). Ces approches, loin d’être opposées, se complètent dans une vision unifiée de la révélation.
2.5. Spiritualité et monachisme
La vie spirituelle des Pères ne se limite pas à la spéculation théologique ; elle s’enracine dans des formes concrètes de prière, d’ascèse et de communion. Le monachisme naît en Égypte au IIIe siècle avec Antoine, dont la vie, relatée par Athanase, inspire un modèle de retrait, de combat spirituel et de transformation intérieure (Athanase, Vie d’Antoine). Le cénobitisme, initié par Pachôme, structure des communautés réglées autour de la prière et du travail.
En Orient, Basile codifie une forme modérée et communautaire du monachisme (Basile, Règles morales). En Occident, Cassien transmet les traditions orientales à la Gaule et réfléchit aux passions, à la prière et à la purification intérieure (Cassien, Conférences). Le monachisme devient un laboratoire spirituel et théologique.
La théologie de la prière, de la contemplation et de la divinisation (théosis) traverse l’œuvre des Cappadociens, d’Évagre le Pontique ou de Maxime le Confesseur. La spiritualité patristique articule ascèse, liturgie et transformation de l’être.
III. Postérité et actualité des Pères de l’Église
3.1. Influence médiévale
Le Moyen Âge reçoit les Pères comme autorités normatives. Augustin marque profondément la théologie occidentale, notamment sur le péché, la grâce et l’Église (Augustin, Confessions ; De civitate Dei). Grégoire le Grand diffuse une spiritualité pastorale et monastique (Grégoire, Moralia in Job). En Orient, Jean Damascène synthétise la patristique grecque (Jean Damascène, Expositio fidei).
Les collections canoniques, les florilèges et la liturgie diffusent leurs écrits. Les universités médiévales s’appuient sur l’autorité des Pères, conciliée à Aristote chez Thomas d’Aquin.
3.2. Réception moderne et contemporaine
La Réforme mobilise aussi les Pères : Luther cite Augustin, Calvin s’appuie sur les premiers siècles pour critiquer les dérives perçues. Le catholicisme tridentin réaffirme l’autorité patristique dans la continuité de la Tradition.
Aux XIXe et XXe siècles, les mouvements de ressourcement (De Lubac, Daniélou, Congar) redécouvrent les Pères comme sources vivantes. L’orthodoxie contemporaine (Lossky, Meyendorff) revendique la continuité patristique. Le dialogue œcuménique s’appuie sur ce patrimoine commun.
3.3. Permanence et enjeux actuels
Les Pères éclairent les débats anthropologiques, ecclésiologiques et spirituels contemporains. Leur conception de la Tradition, de la communauté et de la théologie incarnée offre des repères face aux fragmentations actuelles. Leur lecture de l’Écriture inspire une herméneutique intégrale, à la fois critique et spirituelle.
Leur pensée de la personne, du salut, du langage théologique et de l’unité ecclésiale demeure un chantier ouvert.
Conclusion
Les Pères de l’Église ne constituent pas un simple vestige des origines chrétiennes. Leur pensée est le lieu où s’est élaborée la structure doctrinale, ecclésiale, spirituelle et scripturaire du christianisme. Confrontés aux hérésies, aux mutations politiques et aux défis culturels, ils ont produit une synthèse originale entre révélation et raison, Écriture et Tradition, mystère et institution.
Leurs contributions à la Trinité, à la christologie, à l’exégèse, aux sacrements, à la vie ecclésiale et à la spiritualité ont façonné toutes les étapes ultérieures de la pensée chrétienne. Leur réception médiévale, leur relecture moderne et leur pertinence actuelle montrent que leur œuvre reste matricielle.
Redécouvrir les Pères, ce n’est pas revenir à un passé révolu, mais puiser dans une source vive capable de nourrir la pensée, la foi et la culture contemporaine.
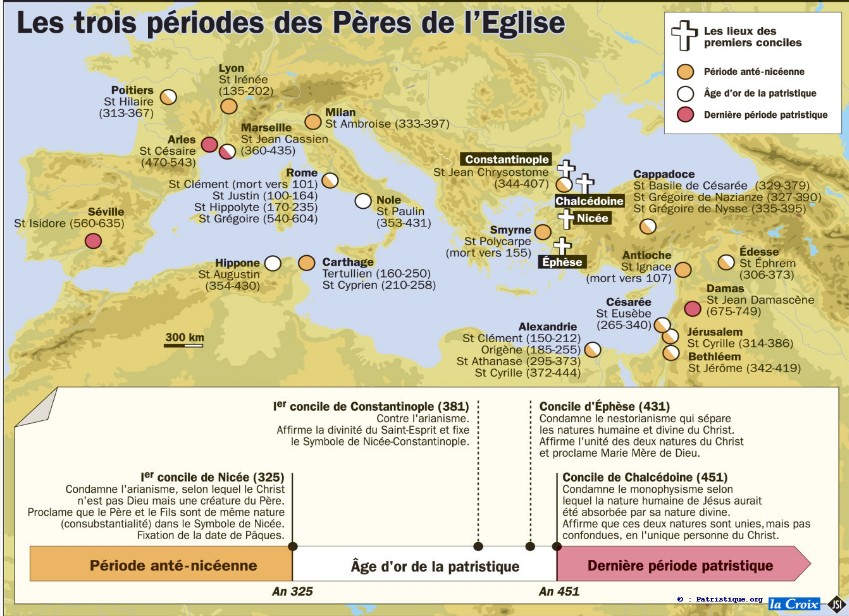
Bibliographie indicative
Sources patristiques
- Athanase, De incarnatione
- Athanase, Vie d’Antoine
- Augustin, De Trinitate
- Augustin, De civitate Dei
- Augustin, Sermons
- Basile de Césarée, Règles morales
- Cassien, Conférences
- Clément d’Alexandrie, Stromates
- Cyrille d’Alexandrie, Commentaire sur Jean
- Grégoire de Nazianze, Discours théologiques
- Ignace d’Antioche, Lettres
- Irénée de Lyon, Contre les hérésies
- Jérôme, Vulgate et lettres
- Jean Chrysostome, Homélies
- Justin Martyr, Apologies
- Origène, De principiis
- Tertullien, Apologeticum, De baptismo, Adversus Marcionem
Études modernes
- Daniélou, J., Histoire des doctrines chrétiennes
- De Lubac, H., Catholicisme
- Congar, Y., Tradition et traditions
- Meyendorff, J., Initiation à la théologie byzantine
- Lossky, V., Essai sur la théologie mystique de l'Église d’Orient
- Brown, P., The Body and Society
- Bouyer, L., La spiritualité des Pères
- Pelikan, J., The Christian Tradition

